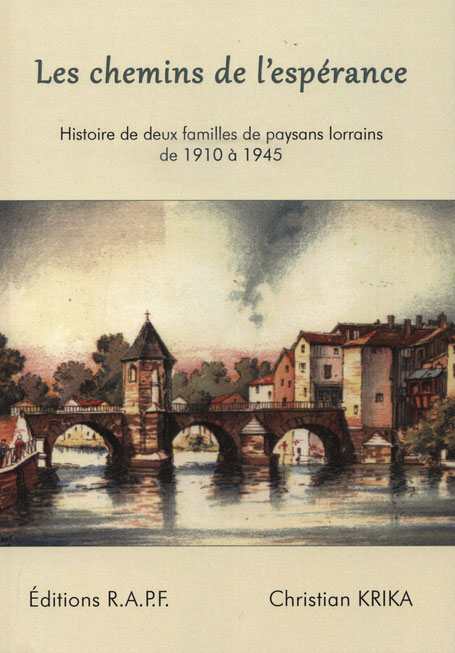
Les chemins de l'espérance
(2 articles de presse en bas de page)
Extrait du livre :
La ferme du père Chrétien était en mauvais état, il n'y avait aucun bétail, seulement des terres... la maison était presque en ruine, la charpente pourrie, les murs décrépits, mais Jean-Baptiste était un homme courageux et la tâche qu'il avait à accomplir ne le rebutait pas, malgré son handicap. Adrien l'aida beaucoup et pour la fin de l'année, la famille put s'installer. Louise voyait son ventre s'arrondir, Adèle aussi. Elles devaient accoucher à peu près au même moment. Au village, c'était la patronne du grand café, la veuve Julliard, qui s’occupait des accouchements sauf dans les cas où les choses se présentaient mal et où l'on faisait appel au médecin. Ce fut Adèle qui accoucha la première, le 20 janvier, à sept heures et demie du matin, la mère Julliard eut à peine le temps de se déplacer que le bébé était déjà au monde.
— Punaise de vérole de bon sang, s'exclama la bonne femme, c'est un beau gamin, eh ben si ça s'était passé comme ça pour moi ! J’aurais été heureuse, moi qui ai souffert le martyr à chaque fois ! (elle avait eu douze gosses et en avait perdu les trois quarts !)
— On l'appellera Richard, déclara Adèle en souriant.
Jean-Baptiste expliqua à sa fille qu'elle avait un petit frère. La petite s'approcha avec méfiance, car elle craignait de faire malencontreusement du mal au bébé. Elle avait onze ans et se rendait compte que le nouveau-né était très fragile et que le moindre faux mouvement pouvait lui être fatal. On lui plaça l’enfant dans les bras et elle s’en trouva tout émue.
— Il est minuscule, murmura-t-elle en dévisageant les autres, de ses grands yeux clairs.
Dans l'après-midi du 8 février, Louise ressentit les premières douleurs alors qu'elle était sortie dans la cour de la ferme pour prendre un peu l'air et, Adrien étant parti au bois avec son père, dans une coupe qu'ils avaient sur le plateau, c'est Marthe qui courut chercher la mère Julliard. Le ciel était plombé, mais il ne pleuvait pas, de temps à autre, même, un rayon de lumière parvenait à percer les lourds nuages noirs.
Aussitôt, on envoya un gosse du village chercher les hommes. Adrien dévala la côte en un temps record.
— Eh ben, y boite plus, constata son père avec une pointe d'humour.
Adrien ne boitait plus, non, les blessures physiques étaient refermées depuis longtemps, déjà, seules persistaient encore, les plaies du cœur.
Il entra en nage, malgré le froid, dans la grande pièce du rez-de-chaussée où l'on avait allongé Louise, mais il n'eut pas le temps de faire ou de dire grand-chose. La mère Julliard, secondée d'Adèle de Berthe et de Marthe, pointa l'index vers lui et déclara d'une voix rauque, presque masculine :
— Non mon gars, c'est pas encore à toi, le bébé est en train de naître et j'ai déjà assez de travail avec la mère sans avoir à m'occuper du père.
Marthe raccompagna son fils dehors.
— Ça va aller, dit-elle en posant doucement sur son épaule, sa main osseuse et déformée par toute une vie de labeur.
Soudain un grésillement gigantesque les fit sursauter tous les deux, les cent vingt kilos de la Veuve Julliard apparurent sur la porte, ses deux mentons esquissaient une mine réjouie qui la faisait ressembler à l'un de ces beaux cochons de lait que l'on faisait tourner en broche les jours de fête.
— Tudieu ! C’est un beau gars ! Elle adressa un clin d'œil à Louise qui se remettait doucement de l'accouchement et ajouta : comme son père !
Georges arriva quelques minutes plus tard en soufflant et en toussant. Il ouvrit des grands yeux effarés quand il vit la toute petite boule rose, chaudement emmaillotée, qui s'agitait au fond de son berceau.
— Il est beau, mon Dieu qu'il est beau, bordel c' qu'il est beau. Ah là là ! Qu’il est beau...
— On dirait qu' tu n'as jamais vu de bébé, soupira sa femme. Notre Adrien aussi, il était beau !
— Il l’est toujours, murmura Louise.
Cette réflexion les fit rire.
— Vous l'appellerez comment ? demanda Georges.
— Sébastien, répondit Louise.
— Notre petit Richard est né à la Saint Sébastien, remarqua Adèle.
Jean-Baptiste avait acheté des animaux dans une ferme de Behonne, à la foire aux bestiaux et il devait encore aller régler quelques affaires.
— Tu pourrais venir avec moi, dit-il à Adrien, on travaille comme des dingues toute l'année et j'ai bien envie d' m'accorder une petite pause, demain. J'ai envie d' retourner à Verdun.
Cette dernière phrase fit sursauter son ami.
— À Verdun, qu'est-ce que veux aller faire là-bas...
— Revoir mes vingt ans, répondit Jean-Baptiste avec un soupçon d'émotion dans la voix.
— C'était la guerre, moi j'ai pas oublié, j'avais 20 ans en 1914 ! Comme Saturnin, d'ailleurs...
— Moi aussi, j'avais 20 ans en 14, mais y a douze ans déjà, bien des choses ont changé depuis la guerre.
— 20 ans ! Ç' aurait dû être les plus belles années de ma vie, reprit Adrien, j'ai pas envie d' retourner là-bas...
— Tu sais, j’pensais la même chose que toi, n'oublie pas que j'y ai laissé une main... et pis y faut pas vivre avec les images du passé, il faut commencer à oublier...
Adrien hocha la tête.
— Peut-être que tu as raison, mais on n'oublie pas les gens qui sont morts à ses côtés, dans des conditions atroces, j’ reverrai ces images-là toute ma vie... j’ reverrai toute ma vie les villes et les villages en feu... j’ n'oublierai jamais ce jeune soldat allemand, mort pour une cause qu'il croyait peut-être juste ! C’est peut-être moi qui l’ai tué.
— Tu sais, si ce gars-là avait été vivant, il ne se serait pas posé autant de questions, s'il t'avait vu le premier, il aurait tiré.
— Peut-être, sûrement même, mais mon cœur saigne quand je pense à toutes ces victimes innocentes, peut-être même oubliées, aujourd'hui.
— Tu parles bien Adrien, mais ce ne sont qu’ des mots. Des mots sans force ni sans valeur. Là où tu n’ voyais que la désolation et la boucherie, le massacre, la tristesse et la mort. La vie a peut-être repris ses droits. En mémoire des copains qui sont morts là-bas : nous, on doit y retourner !
Adrien baissa la tête comme un enfant que l'on réprimande.
— C'est bon, j'irai avec toi, souffla-t-il.
À la première heure, ils prirent le « Tortillard », ce bon vieux tacot qui avait contribué au transport de troupes et de matériel, lors de la bataille de Verdun et arrivèrent à destination en fin de matinée. Adrien sentit son cœur se serrer lorsqu'ils visitèrent, à la hâte, car leur temps était compté, le site de Douaumont. Les herbes folles courraient sur la campagne encore mutilée par les bombardements. Le long du chemin qui conduisait à ce qui était autrefois le centre du village, des épicéas avaient été récemment plantés et pointaient leurs cimes, encore petites, vers le ciel. Des nuages assombrissaient l'horizon, laissant parfois, tout de même, filtrer les rayons du soleil.
Les deux hommes demeurèrent silencieux, là, un long moment, sur ce morceau de terre où tant de soldats avaient donné leur vie où l’odeur de la poudre et du sang ne s’était peut-être pas encore totalement estompée. Au cœur de ce petit village qui autrefois, vivait paisiblement au rythme des saisons... au cœur de ce petit village de Meuse, disparu à tout jamais, à cause de la folie meurtrière des hommes. Adrien ferma doucement les yeux et perçut le bruit encore lointain des bombardements, le sifflement des balles semblait se rapprocher de seconde en seconde. Il rouvrit les yeux et prit conscience que seule son imagination avait, un court instant, évoqué cette bataille dont le souvenir resterait pour toujours gravé dans la poussière de cette terre de Lorraine. Alors Adrien essaya de se souvenir des bruits de la vie des villages, et du sien, en particulier. Il essaya d'imaginer Douaumont, qu'il n'avait pas connu avant-guerre. Il s'efforça de songer au bruit que faisait le marteau sur l'enclume du maréchal ferrant, le meuglement des vaches rejoignant leurs étables, le galop des chevaux traversant la grand-rue en tirant de lourds chariots. Il essaya d'imaginer la vie, tout simplement, l’eau de la petite fontaine coulant fraîche et claire, les cris joyeux des enfants allant à la petite école communale, le doux murmure des conversations des femmes se rendant au lavoir... il essaya d’imaginer tout cela, mais n'y parvint pas et n'entendit que le silence de la mort et du désespoir ! Le jeune homme sentit ses yeux s’embuer.
Les deux amis se tenaient là, côte à côte, immobiles et respectueux. L'haleine glacée de février balayait leurs visages blêmes, malgré le froid. Jean-Baptiste fut le premier à rompre le silence, le vent happait la moitié de ses mots.
— I’ paraît qu’ils vont construire un monument.
— Ça n’ fera pas r'venir les morts, grinça Adrien en frissonnant.
— Non, mais ça empêchera peut-être les vivants d'oublier.
Ils revinrent tard dans la soirée et ne parlèrent pas beaucoup, chacun pensait à l'enfer qu'il avait vécu là-bas, à Verdun. De temps en temps, Jean-Baptiste jetait un œil sur son unique main et si Adrien l’avait regardé à ce moment-là, il aurait remarqué la profonde mélancolie qui se dégageait de ses yeux sombres.
Deux jours plus tard, alors qu'Adrien redescendait du plateau, il trouva Louise qui pleurait, assise à côté de la cheminée, le petit dormait sur ses genoux.
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Adrien, ton père... il a eu un malaise. Le docteur est en haut, avec Marthe.
Il se précipita dans l'escalier, gravit les marches de bois qui gémissaient sous chacun de ses pas et entra, rapidement, mais sans bruit, dans la chambre où le médecin auscultait son père dans un silence que seul troublait le craquement sec des bûches dans l'âtre. Au bout de quelques instants, le docteur, un homme d'une soixantaine d'années se redressa et leur fit signe de quitter la pièce.
— Alors docteur, interrogea la mère lorsqu'ils furent en bas.
— Je... je ne peux rien faire malheureusement, le cœur est usé... usé par toute une vie de travail : il... il ne passera pas la nuit.
— Docteur, on ne peut pas le placer à l'hôpital ?
Le vieux médecin baissa les yeux, fuyant les regards de Marthe et Adrien.
— Non, il ne supporterait pas le transport... je suis désolé. La science d'aujourd'hui ne nous permet pas encore de sauver autant de vies que nous le souhaiterions... un jour, peut-être...
Il quitta la ferme avec ce sentiment d'impuissance qui hante tout médecin lorsqu'il sait que l'heure de son patient est venue et qu'il n'y a plus rien à faire.
Acheter la version papier en cliquant ici


