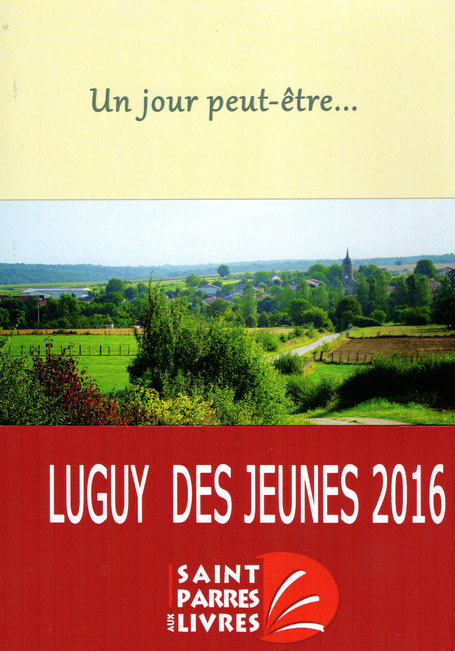
Un jour peut-être...
Le "Lugy" des jeunes :
Depuis quelques années, un prix est décerné à un ouvrage, par les étudiants de la ville de Saint-Parrès-aux-Tertres. En 2016, cette récompense a été attribuée à mon livre "Un jour peut-être..."
Extrait du livre :
Mathilde était descendue, comme tous les matins, jusqu’à la lisière de la forêt toute proche pour y ramasser quelques branches mortes. La brise de cette fin d’été caressait ses longs cheveux blonds. Christophe, son jeune frère gambadait joyeusement autour d’elle en tirant parfois sur les franges de son fichu pour la taquiner. Depuis le début de la guerre, tous les jours, c’était la même chose : il fallait aller chercher du bois pour préparer la mauvaise saison. Les Allemands toléraient le ramassage du bois mort, mais cela n’était pas suffisant pour chauffer la maison et l’hiver précédent avait été difficilement supportable. La longue silhouette de la jeune femme se confondait avec le feuillage de la forêt, en ce début du mois de septembre 1942. Elle n’avait pas encore vingt ans mais secondait déjà beaucoup sa mère dans les tâches quotidiennes. Mathilde était l’aînée d’une fratrie de sept enfants : deux filles et cinq garçons. Christophe était l’avant-dernier et Juliette était la cadette. Tous les matins, la patrouille allemande les croisait martelant le sol du pas cadencé de ses soldats et, à chaque fois, la jeune femme remarquait le sourire aimable de l’un d’entre eux. Alors, doucement, un peu gênée, elle baissait ses jolis yeux clairs tandis que son frère, sans prêter attention à tout ceci, se blottissait furtivement contre elle avec une réelle appréhension. Le père, André, était l’unique cordonnier du village tandis que la mère, femme chétive, s’épuisait à élever leur marmaille. Il n’y avait plus beaucoup de souliers à ressemeler en cette période trouble et la vie était pénible. Depuis 1940, l’occupant avait réquisitionné tout ce qui pouvait l’être ! Seul peut-être en zone libre, trouvait-on encore de quoi manger… mais rien n’était moins sûr. André avait toujours été un bon mari et un bon père. Il n’avait jamais levé la main sur sa femme ni même sur ses enfants et si parfois il avait pris la trique pour donner une bonne correction à René, l’aîné, le gosse en était à chaque fois ressorti indemne, courant bien plus vite que son père ! André, donc, était un homme calme et attentionné qui avait toujours tout fait pour préserver le bien-être des siens et, avant-guerre, tous les dimanches, il les emmenait en ville où chacun pouvait écouter l’entraînante musique de l’accordéon en dégustant des jus de fruits. À présent, il n’était plus le même : anxieux, coléreux et parfois agressif. Il lui arrivait souvent d’abattre un poing rageur sur la grosse table qui occupait le centre de la cuisine pour imposer le silence à sa maisonnée.
— André, je ne te reconnais plus, se lamentait parfois sa femme.
Alors, il baissait la tête comme un gosse que l’on réprimande, presque honteux de son comportement.
Un matin, alors que Mathilde était occupée à nettoyer l’atelier et que son père s’affairait au grenier, la cloche du magasin tinta. La jeune femme leva la tête surprise car cela n’arrivait plus aussi souvent qu’autrefois. Elle blêmit en reconnaissant le jeune soldat allemand qu’elle croisait pratiquement tous les matins depuis plusieurs jours.
— Bonjour mademoiselle, murmura-t-il sans le moindre accent.
Elle demeura bouche bée, incapable de dire quoi que ce fût.
Le jeune homme la dévisagea. Elle baissa timidement les yeux.
— Bonjour monsieur, répondit-elle enfin. Vous… vous désirez ?
Il baissa le regard à son tour. Il aurait voulu lui dire que c’était elle qu’il désirait, qu’il l’aimait sans même la connaître, depuis le premier jour où il l’avait croisée dans la rue. Il aurait voulu lui dire qu’il guettait depuis un moment déjà, l’instant propice où il pourrait entrer dans le magasin en étant pratiquement sûr que ce serait elle qui le servirait mais il n’osa pas, évidemment ! Qu’aurait-elle pensé de lui, alors ? Il leva les yeux et masquant à peine son trouble, balbutia :
— Je… je voudrais… je voudrais une boîte de cirage.
— Oui, bien… de quelle couleur ?
Il parut réfléchir, comme si la question était inattendue. Peu lui importait la couleur, ni même le cirage. Il n’était venu que pour la voir, elle.
— Noir… oui c’est cela… du cirage noir.
— Vous… hem… vous parlez parfaitement notre langue…
Le visage du jeune homme s’éclaira.
— Oui… ma mère est française et j’ai séjourné de longues années chez ma grand-mère à Moulins dans mon enfance… quelle région magnifique !
À cet instant des pas résonnèrent dans l’escalier.
— Pourrais-je vous revoir ? demanda subitement le jeune allemand surpris lui-même de sa témérité.
Mathilde le dévisagea étonnée, sans se rendre compte que ses yeux, subitement devenus plus brillants que l’instant d’avant, trahissaient son trouble.
— Mon père arrive, il vaut mieux qu’il ne vous trouve pas ici… il… enfin… il n’apprécie pas trop votre présence… enfin je veux dire… celle de l’armée allemande.
Il lui adressa un sourire presque juvénile.
— Alors ? demanda-t-il.
Elle baissa timidement les yeux, un peu gênée, mais malgré elle, elle dut bien reconnaître que ce jeune homme lui plaisait beaucoup. Les pas se rapprochaient de seconde en seconde.
— Alors ?
— Bon…, murmura-t-elle. Tout à l’heure, disons vers sept heures… je serai dehors. Partez maintenant. Partez vite.
La porte qui conduisait à l’escalier du grenier s’ouvrit quasiment en même temps que se fermait celle du magasin.
— C’était qui ? demanda le père.
— Un soldat… un Allemand. Il… il voulait du cirage.
André cracha par terre.
— Du cirage ! Il ne peut pas aller en chercher dans sa caserne, il faut qu’ils viennent nous emmerder jusqu’ici. Saleté de Boches ! Saleté de guerre !
— Papa, c’est quand même un client…
— Ouais ! Ben j’espère que tu lui as fait payer le prix fort !
Un sourire éclaira le doux visage de la jeune fille, dessinant de tendres fossettes de part et d’autre de ses jolies lèvres. Elle reprit son ouvrage en chantonnant doucement.
— Tiens, voilà qu’ tu chantes, maintenant ? Comme autrefois, remarqua le père.
Elle s’arrêta net.
— Non… continue, la supplia-t-il, ça met un peu de gaieté dans notre vieille bicoque.
La joie emplit son cœur et elle regretta un peu l’absence du phonographe, cassé pendant l’exode. Sa mère revint du marché où elle n’avait pas trouvé grand-chose à acheter, si ce n’est quelques carottes et des topinambours.
— Tiens voilà notre Mathilde qui chante ? Tu as l’air toute gaie ma belle. C’est bon va, continue donc, ça nous mettra un peu de baume au cœur.
Mathilde trouva l’après-midi interminable mais paradoxalement, elle se demanda pourquoi elle avait répondu favorablement à ce qui était, il fallait bien le reconnaître, des avances de la part de ce jeune Allemand. À présent la jeune femme était confrontée à un véritable dilemme. Devait-elle ou non aller à ce rendez-vous ? Elle se retira un peu dans sa chambre, prétextant une migraine soudaine, pour réfléchir. « Ce soldat est quand même un ennemi » songea-t-elle mais aussitôt une autre pensée se précipita dans sa tête. Oui, bien sûr ! C’est un ennemi, mais c’est avant tout un être humain, avec un cœur et des sentiments ! Et puis… il lui plaisait beaucoup. « Il est séduisant pour un Allemand » murmura-t-elle. Cette réflexion la fit sourire : comme si les Allemands étaient moins séduisants que les autres. Sa décision était prise : elle irait au rendez-vous. De toute façon, cela ne pouvait guère porter à conséquence. Et puis, le couvre-feu n’était qu’à vingt heures.
À dix-huit heures trente, elle sortit.
— Un peu d’air frais me fera du bien, précisa-t-elle à sa mère.
— Je peux venir avec toi ? demanda Christophe.
— Non p’tit frère, je voudrais être tranquille.
Le gamin baissa la tête, vexé, c’était la première fois que sa sœur refusait qu’il l’accompagnât. Mathilde s’aperçut un peu inquiète qu’elle avait oublié de donner un lieu précis pour le rendez-vous. Elle ne pouvait rester devant le magasin de ses parents ni arpenter le trottoir comme une fille des rues. Que devait-elle faire ? Elle prit finalement le parti de marcher doucement vers la sortie du bourg. Mathilde n’eut pas longtemps à attendre. Au bout d’une dizaine de minutes, elle entendit un léger grincement derrière elle. Un cycliste arrivait à sa hauteur, c’était le jeune soldat de tout à l’heure dont elle ignorait jusque au prénom…
Mathilde continua à marcher et tous deux quittèrent le village en silence, dans la nuit tombante. Arrivés à l’ancien lavoir, le jeune homme cacha sa bicyclette derrière et ils pénétrèrent dans le bâtiment. À cette heure, l’endroit était totalement désert.
— Merci d’être venue, déclara le jeune soldat.
— Je me demande pourquoi j’ai accepté, murmura Mathilde.
— On ne fait rien de mal…
— Je ne sais même pas comment vous vous appelez.
— Moi si, vous vous prénommez Mathilde, c’est un très charmant prénom.
— Co… comment le savez-vous ?
Il esquiva la question et son regard se perdit vers le village.
— Moi c’est Dieter, on peut traduire ça par Didier, je pense. »
Ils demeurèrent là un bon moment à discuter, puis l’heure du couvre-feu arriva. Ils se retrouvèrent, pratiquement à la même heure, une à deux fois par semaine, mais plus au vieux lavoir. Il y avait, un peu plus loin une vieille maison en ruine, abandonnée depuis l’exode, c’était un endroit bien plus tranquille et l’on ne risquait pas de les y déranger. À présent, ils se tutoyaient et s’embrassaient, l’amour avait prit la place du simple flirt. Un soir Dieter parla de la vie en Allemagne bien avant la guerre.
— Il faut reconnaître qu’on n’avait plus rien à manger. Mon père avait une fabrique qu’il a dû fermer. Puis les nazis sont venus au pouvoir, on a eu de la nourriture dans nos assiettes. Les chômeurs ont retrouvé du travail ! Pour ça, le peuple allemand leur est reconnaissant.
Il s’arrêta un court instant pour réfléchir peut-être à ce qu’il allait ajouter, puis reprit :
— On a eu à manger dans nos assiettes… mais… mais on a vu des vitrines de magasins cassées, des gens tabassés dans les rues, des livres brûlés.
— Des… des gens tabassés ? même en Allemagne ?
— Oui, petite Mathilde, même en Allemagne… là-bas, dans mon pays, on ne peut pas faire ce que l’on veut… les enfants sont enrôlés dans les jeunesses hitlériennes et malheur à ceux qui ne sont pas d’accord avec l’ordre établi.
— Mais vous ne pouvez rien faire ? Vous révolter, par exemple…
Le jeune homme eut un sourire presque moqueur.
— Non, ils sont partout, le pays est tenu par une poigne de fer. Ils ont des yeux et des oreilles partout ! Malheur à qui désobéit.
— Mais, il était possible de déserter de l’armée. Si tout le monde avait refusé de se battre…
— Non… déserter… non, c’est impossible, j’aime trop mon pays. Ma famille est toujours là-bas, ça signifierait la mort pour eux. Où irais-je d’ailleurs ?
— Mais tu m’as parlé d’une parente à Moulins…
— Ma grand-mère… oui. Mais elle est morte il y a quelques années et… je n’ai plus qu’un oncle pour toute famille, dans l’Allier. Non, je ne peux pas quitter l’armée, d’ailleurs, je ne le veux pas ! L’Allemagne est ma patrie et je dois défendre son sol. Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous les français…
Il s’interrompit net, non il n’avait pas voulu dire ça, il avait parlé trop vite.
— Je veux dire… enfin, pour vous, nous sommes des envahisseurs. Dans ton cœur, petite Mathilde, c’est nous, les Allemands qui sommes les méchants. Ce sont nos troupes qui ont attaqué la France, pas le contraire. Tu penses que c’est nous qui devons perdre la guerre… parce que c’est à cause de nous qu’elle a commencé.
Elle ne répondit pas, elle ne savait que penser, tous ces événements la dépassaient. Elle ne demandait qu’à aimer et à être aimée. Elle regarda Dieter : comme les traits de son visage s’étaient soudain durcis ! Il n’avait connu que la misère, d’abord, puis était venue l’Allemagne d’Hitler ! Sa jeunesse s’était évanouie dans cet immonde cauchemar.
Ils demeurèrent un long moment sans parler, puis il serra Mathilde très fort contre lui et ils se donnèrent l’un à l’autre. Dès que la guerre serait terminée, quel qu’en fût le vainqueur, ils se marieraient, Mathilde le savait ! Il ne pourrait en être autrement ! C’était écrit quelque part dans les étoiles ! Et l’enfant qu’elle lui donnerait peut-être un jour grandirait à leurs côtés dans un flot de bonheur intense. Mathilde vit Dieter encore deux fois dans le courant de la semaine suivante puis, un soir qu’elle l’attendait au lieu habituel, il ne vint pas. Elle attendit une demi-heure… trois-quarts d’heure. L’inquiétude naquit dans son cœur puis elle perçut un craquement. « Enfin » pensa-t-elle. Elle se précipita vers la porte aux planches disjointes et découvrit une silhouette trapue qui se découpait dans la pénombre. C’était un soldat allemand qu’elle ne connaissait pas.
— Qui… qui êtes-vous ? demanda-t-elle surprise.
L’autre parlait très mal le français mais il lui tendit un billet sur lequel un message était griffonné à son intention :
« Petite Mathilde… ma chérie,
Ma compagnie a été obligée de quitter subitement la caserne pour une destination inconnue… je t’aime, ne t’inquiète pas pour moi…
À bientôt… je t’embrasse…
Dieter »
Dans les jours qui suivirent, la jeune femme découvrit que la compagnie du jeune soldat était partie grossir les rangs des armées du front de l’Est, quelque part en Russie. Radio Paris relatait, à grand renfort de propagande, les revers de l’Armée rouge et les victoires écrasantes de la Wehrmacht. Moscou n’allait pas tarder à tomber sous le rouleau compresseur de l’envahisseur. Bientôt toute la Russie de Staline serait sous le joug des armées d’Hitler.
Au fil des jours suivants, Mathilde sombra dans la mélancolie, n’ayant plus goût à rien ! Le doute s’insinua en elle, puis une sorte de panique lorsqu’elle s’aperçut qu’elle était enceinte. Elle décida, pour être sûre, d’aller consulter un médecin, mais pas le docteur Faucourt, qui était le médecin de famille, et en qui elle n’avait pas particulièrement confiance. Elle avait peur, dans le cas où ses craintes se confirmeraient, que la nouvelle se répandît rapidement au village, les souillant un peu plus, sa famille et elle. Elle se rendit à la ville voisine, le médecin confirma ce qu’elle redoutait tant et c’est en pleurs qu’elle sortit de son cabinet. La naissance aurait lieu vers la fin juin ou au début du mois de juillet. Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi ?
De retour à la cordonnerie, Mathilde n’eut pas le courage d’affronter le regard de ses parents et monta directement dans sa chambre, qu’elle partageait avec Juliette.
— Mathilde, ma petite, tu es malade ? demanda sa mère.
N’obtenant pas de réponse, elle s’approcha de l’escalier.
— Mathilde ?
— Bah, laisse-la donc, grogna son mari qui n’avait rien remarqué.
Jacqueline n’en resta pas là et gravit, inquiète, l’escalier qui montait aux chambres. La porte n’était pas fermée à clef, la mère entra sans frapper et aperçut sa fille recroquevillée, en pleurs, sur le grand lit aux draps roses qu’elle partageait avec sa sœur.
— Qu’y a-t-il ma petite ?
— Oh maman… maman…
Pouvait-elle dissimuler la vérité plus longtemps ? Les sanglots secouèrent son corps.
— Ma petite qu’y a-t-il ? insista sa mère angoissée.
Dans un état second, étonnée même d’entendre sa propre voix, un peu comme si c’était celle de quelqu’un d’autre, elle lâcha dans un gémissement :
— Je… je suis enceinte…
Elle s’attendait à une réaction de colère et peut-être même de rejet de la part de sa mère mais fut surprise par son comportement. Jacqueline sembla d’abord abattue puis, s’efforçant de garder son calme, avalant péniblement sa salive, elle demanda :
— Tu… tu en es sûre ?
— Oui… le médecin…
— Le docteur Faucourt ?
— Non… un autre… je suis allée en voir un autre, en ville.
— Tu sais… qui… tu sais qui est le père ? souffla Jacqueline.
— Maman… bien sûr, gémit la jeune femme, pour qui me prends-tu ?
La mère prit un mouchoir et tapota très doucement les joues humides de sa fille. Avec le recul, elle avait un peu honte de sa réflexion mais cela avait été sa façon, inconsciente sans doute, de marquer sa désapprobation et sa colère.
— Je… je ne sais pas ce qu’on peut faire, avoua-t-elle. Je vais laisser passer un jour ou deux… puis je vais en parler à ton père.
— Non, maman ! Non pas encore ! Je t’en supplie… attends un peu…
— Je ne peux pas… c’est ton père… il doit savoir … j’attendrai un jour ou deux… et puis il faudra bien qu’on le lui dise.
La jeune femme releva doucement la tête puis sombra de nouveau dans le désespoir.
— Allons ma chérie, murmura sa mère. Calme-toi… je suis là, tu peux compter sur moi, tu le sais bien…
Jacqueline essuya une nouvelle fois les larmes de sa fille puis Mathilde lui raconta son aventure avec Dieter.
— Maman, je l’aime et il m’aime, lui aussi… j’en suis sûre… je sais qu’il m’aime… après la guerre, on se mariera… peu m’importe qu’il soit allemand ou pas, je l’aime
— En attendant, il est bel et bien parti.
— Oui, mais il n’y est pour rien… après la guerre, il reviendra, il a de la famille à Moulins. Il reviendra ! Et il m’épousera, j’en suis certaine !
— Et…, reprit la mère en se taisant aussitôt.
Sa fille leva les yeux vers elle.
— Et s’il ne revenait jamais, c’est ça que tu allais dire ?
Jacqueline baissa la tête.
— Ce… ce serait terrible, je sais...
— S’il ne devait jamais revenir… je me laisserais mourir.
— Ne sois pas stupide…
Mathilde plongea son regard dans celui de sa mère et déclara dans un sanglot :
— Je préfère la mort plutôt que de vivre sans lui.
— Et l’enfant que tu portes, tu y songes ? Et nous ? tu penses un peu à nous ?
La jeune femme se jeta dans les bras de sa mère…
Un jour passa… puis deux. Jacqueline informa son mari de la situation. Ce dernier entra dans une colère sans nom. Jamais sa femme ne l’avait vu ainsi !
— Ma fille ! La dernière des dernières ! Et avec un Boche en plus !
— Ne crie pas comme ça, tu vas ameuter tout le quartier, répliqua sa femme en regardant autour d’elle.
— Je m’en fiche, répliqua André en baissant tout de même un peu la voix. Où est-elle ?
— Elle est partie chercher du bois… mais je t’en prie, André, te mettre dans cet état ne servira à rien. Réfléchissons plutôt à ce qu’on peut faire.
— Ah ! la p’tite salope ! Elle cachait bien son jeu ! Sainte nitouche ! Elle a même pas vingt ans !
— Réfléchissons à ce qu’on peut faire, répéta calmement sa femme.
— Que veux-tu faire ? À part la faiseuse d’anges ! Je ne vois pas d’autre solution.
— Arrête donc de divaguer. Cet enfant, elle veut le garder…
— Ben tiens, et pis c’est papa qui l’élèvera ? Pas de ça chez nous : si elle garde son bâtard elle ne remet plus les pieds ici.
— Si tu la mets à la porte, je pars aussi ! répliqua fermement Jacqueline.
André haussa les épaules. À cet instant précis, la porte du magasin s’ouvrit faisant tinter la petite cloche et Mathilde, le visage défait, les yeux cernés par le chagrin, apparut, flanquée de son frère.
— Disparais ! lâcha le père. Tu n’es plus ma fille.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Christophe au comble de l’étonnement.
— Rien, mon chéri, répondit sa mère, rien. André, calme-toi, tu crois que c’est un spectacle pour les gosses ?
André haussa de nouveau les épaules, ne sachant plus quelle attitude adopter. Il était hors de lui, mais Jacqueline avait raison, il y avait les autres enfants…
Mathilde monta en pleurs, se réfugier dans sa chambre, tandis que René et Baptiste, ses deux autres frères, pénétraient à leur tour dans la maison.
Le père les dévisagea, puis se calma un peu.
— Il faut la marier, reprit-il sur un ton plus modéré. Et vite ! Tiens, avec cet imbécile de Tenan.
Jacqueline sursauta.
— Pourquoi lui plutôt qu’un autre ?
— Parce que ça fait des années qu’il lui court après.
— Des années… elle n’a que dix-neuf ans, répliqua la mère. C’est encore une enfant !
— Une enfant ? Pas pour tout ! Et pis je m’ comprends ! Je l’ verrai demain et je suis sûr qu’il sera d’accord.
— André, tu ne peux pas faire ça. Tu penses un peu à ce qui se dira en ville ? Tu ne vas pas aller vendre notre fille comme ça ?
— Ne t’inquiète pas, je sais comment m’y prendre ! L’autre imbécile m’en parle à chaque fois qu’il me voit ! J’ n’aurai qu’à lui tendre un peu la perche et sa s’ f’ra tout seul !
Les yeux de Jacqueline s’emplirent de larmes
— Et la petite ? Tu penses un peu à elle ? À la vie qu’elle va avoir, il est beaucoup plus âgé qu’elle… pense un peu à notre Mathilde.
— Et elle ? Elle a pensé à nous ? répliqua André. Elle n’avait qu’à réfléchir avant. Tenan vaut bien son sale Boche ! Elle n’a rien à dire : ce s’ra comme ça et pas autrement !
— Tu es sûr qu’on ne le regrettera pas plus tard ? demanda encore la mère d’une voix lasse.
— Et pourquoi ? il a du bien, il n’arrête pas de s’en vanter, d’ailleurs, et il n’est pas feignant.
— Il n’y a pas que l’argent, dans la vie…
Le père ne répondit pas et disparut dans son atelier.
Henri Tenan était un homme fort et courageux, fils de bûcheron, le travail de la terre ne le rebutait pas. Il travaillait comme journalier dans les fermes du pays au fil des saisons. Très économe, il se contentait de peu de chose, plaçant tout l’argent qu’il gagnait dans des lopins de terre qu’il achetait de temps à autre. Un vieil oncle lui avait également laissé en héritage la petite maison, située juste à l’entrée du bourg, qu’il habitait actuellement ainsi que quelque argent auquel il s’était gardé de toucher dans l’immédiat. Pour le père de Mathilde c’était un bon parti. Certes, il avait vingt-cinq ans de plus que la jeune femme, mais cela ne valait-il pas mieux ? Il était bon, pour une femme, en ces temps de tourmente, d’avoir un homme mûr, solide, sur lequel s’appuyer. Et puis comme ça le gosse à venir aurait un père. Tenan avait des terres et Mathilde ne venait pas sans rien. Bien sûr sa dot, à elle, n’était pas très importante, mais c’était une jolie fille et beaucoup de gars au bourg n’auraient pas hésité à aller demander sa main à son cordonnier de père qu’il y ait une dot ou non.
La jeune femme dut se plier à la décision paternelle et fit contre mauvaise fortune bon cœur. Son enfant aurait un père ! Son cœur saigna lorsque le souvenir de Dieter revint à son esprit. « Mon Dieu, faites qu’il revienne un jour ». Elle ne se posa pas la question de savoir ce qu’elle ferait dans un tel cas.
Henri Tenan avait senti depuis plusieurs jours un fléchissement dans le comportement du père de Mathilde et avait profité de ce que ce dernier lui avait offert un verre au café du père Fournier pour aborder, pour la millième fois, la question qui lui brûlait tant les lèvres.
— Si vous m’ la donnez, croyez bien qu’elle s’ra heureuse.
Le père avait fait mine de résister tout de même un peu, puis avait finalement cédé.
— J’ la prendrai même sans rien, appuya Tenan, j’ai de quoi vous savez.
— Et qu’est-ce que tu crois ? répliqua André un peu vexé. Même avec cette putain de guerre on a quand même un peu de bien. On n’ te la donnera pas sans rien.
— La p’tite ?... Elle est d’accord ? demanda soudain Tenan avec un soupçon d’inquiétude.
— Oui, affirma le père, en se gardant bien de révéler que sa fille était enceinte.
Quelques jours passèrent. À présent, chaque matin, alors que l’automne flamboyant de cette fin octobre décorait les forêts, Henri apportait des fleurs à celle qu’il appelait dorénavant « ma princesse ». Il passait alors plusieurs heures en sa compagnie, lui parlant des années qu’il avait passées en Indochine, alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme.
— Tu vois, ma princesse, quand nous serons mariés, je te donnerai de beaux enfants et puis, j’achèterai peut-être une ferme et on y établira notre petite famille. Quand cette fichue guerre sera finie… tu sais j’ai de l’argent de côté, j’ai fait de bonnes affaires, aussi… de très bonnes affaires, tu peux me croire !
Mathilde baissa les yeux, elle pensait à Dieter. Où était-il ? Qu’était-il devenu ? Le reverrait-elle un jour ? Elle adressa un sourire à Henri et vit aussitôt son gros visage de paysan rayonner de bonheur.
— Ma princesse, murmura-t-il.
Elle le dévisagea et songea qu’il la rendrait certainement heureuse, très heureuse, même. Oui, cet homme respirait la bonté. Il n’était pas beau et son corps disgracieux n’avait rien de comparable avec celui, très harmonieux, du jeune homme dont elle pleurait la disparition mais son âme était pure et il leur donnerait un toit à son enfant et à elle. Mathilde se sentit soudain confuse, presque honteuse à l’idée de lui cacher qu’elle était enceinte. Elle pensa qu’elle devait lui révéler la vérité mais aussitôt songea à ses parents. Peut-être qu’Henri ne la voudrait plus pour femme. Alors, ce serait terrible pour eux. On ne manquerait pas d’en raconter au pays. Non, Mathilde n’avait pas le droit de trahir ainsi ses parents. Tant pis si elle devait en souffrir plus tard ! Tant pis si sa vie, à elle, devait être gâchée, seul lui importait le bonheur de sa famille et de l’enfant qu’elle mettrait un jour au monde. Tous les matins Henri rendait visite à sa princesse, un bouquet à la main. Parfois il lui apportait une friandise, denrée pourtant rare en cette époque de guerre.
— Tu verras ma douce, nous aurons une vie heureuse, nous aurons beaucoup d’enfants, comme dans les contes de fées.
Cette comparaison la fit sourire.
Pour acheter ce livre, cliquez ici
